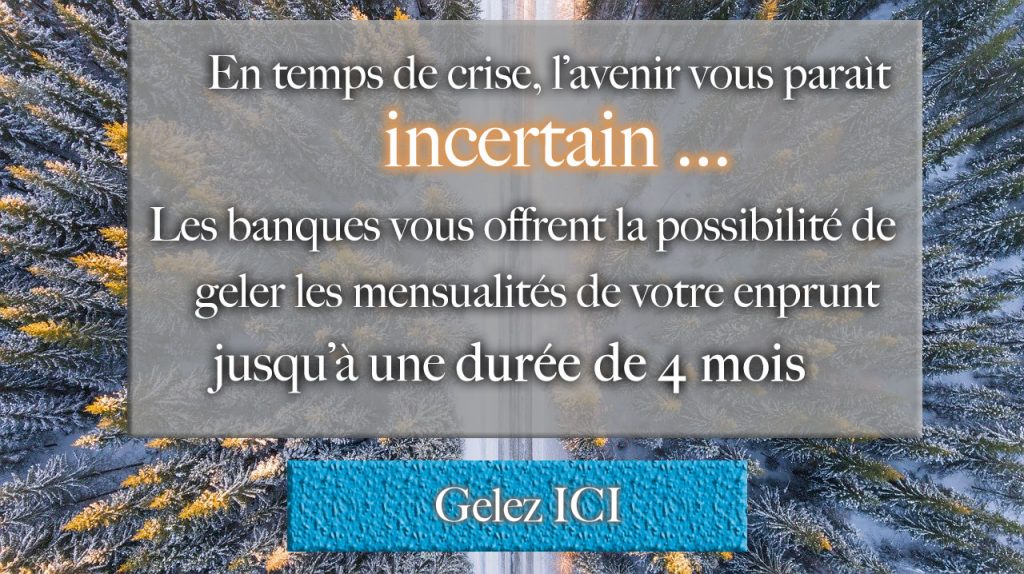L’ajustement tant attendu de l’indice des prix à la construction en Israël, opéré pour la première fois depuis 14 ans, a finalement déçu le secteur du bâtiment. Les entrepreneurs espéraient une révision significative pour refléter la hausse réelle des coûts de construction, notamment en matière de main-d’œuvre. Pourtant, l’indice actualisé publié par le Bureau central des statistiques n’a enregistré qu’une faible augmentation de 0,4 %, remettant en cause la représentativité de cet outil.
Une révision méthodologique après 14 ans d’immobilisme
Le Bureau central des statistiques israélien a récemment actualisé la composition de l’indice des prix à la construction résidentielle – un indicateur clé pour le secteur immobilier. Cette révision, la première depuis 2011, était censée intégrer les mutations profondes du marché, en particulier l’évolution des coûts de la main-d’œuvre suite aux bouleversements provoqués par la guerre.
Cet indice, utilisé pour indexer les contrats de vente de logements neufs ainsi que les accords entre promoteurs et sous-traitants, repose sur un panier de postes budgétaires pondérés selon leur poids relatif dans le coût global d’un projet. Il inclut les matériaux, les salaires, la location d’équipements et les frais généraux.
Des attentes élevées… pour un résultat modeste
Alors que les professionnels anticipaient une augmentation marquée de l’indice avec la nouvelle formule, le résultat publié pour août s’est limité à +0,4 %. Un chiffre largement en deçà des attentes, provoquant une onde de frustration dans le secteur.
L’enjeu central porte sur la pondération des salaires dans l’indice. Selon les entrepreneurs, cette composante a explosé depuis la guerre en raison de la disparition quasi totale de la main-d’œuvre palestinienne et de la nécessité de recourir massivement à des travailleurs étrangers, nettement plus coûteux.
À titre d’exemple, en 2011, 95 % des ouvriers du bâtiment étaient israéliens, contre seulement 5 % de Palestiniens ou de travailleurs étrangers. À la veille de la guerre, ces derniers représentaient déjà 29 % de la main-d’œuvre, et aujourd’hui, en l’absence des travailleurs palestiniens (hors clandestins, non comptabilisés), la dépendance vis-à-vis des étrangers a atteint un niveau sans précédent.
Salaires doublés, poids minoré dans l’indice
Conséquence directe : les coûts salariaux ont grimpé en flèche. Le tarif journalier d’un ouvrier étranger varie aujourd’hui entre 1 000 et 1 900 shekels, contre 250 à 500 shekels pour un ouvrier palestinien avant la guerre. Pourtant, la pondération des salaires dans l’indice est passée de 43 % à seulement 42 %, une baisse légère mais symbolique, qui a ulcéré les acteurs du secteur.
Selon Aryeh David, vice-président de l’Association des entrepreneurs, les coûts salariaux réels représentent aujourd’hui 60 à 70 % des coûts totaux de construction, loin des 40 % environ pris en compte dans l’indice.
Une nouvelle méthodologie de calcul
Le CBS a profondément modifié sa méthode de collecte des données. Contrairement au passé, où les données provenaient directement des promoteurs, le nouveau calcul repose sur l’analyse de 191 dossiers de permis de construire obtenus auprès des autorités locales. Ces “gramushkas”, plans détaillés des projets, ont été traités par un modèle informatique, appuyé par des experts, pour déterminer les quantités et coûts des matériaux et composants.
Autre nouveauté : la différenciation entre les logements en immeubles collectifs et les maisons individuelles, ainsi que l’introduction d’un poste distinct pour les frais indirects (électricité, eau, assurances, direction de projet, sécurité, location de matériel, etc.).
Certaines pondérations ont été revues :
- Les ouvriers en carrelage et revêtement passent de 8 % à 19 % du poste salaires ;
- Les maçons de 3 % à 5 % ;
- Les électriciens de 5 % à 7 %.
Un décalage entre réalité du terrain et données statistiques ?
Pour les entrepreneurs, ces ajustements sont insuffisants pour refléter la flambée des coûts depuis le début de la guerre. Le président de l’Association des entrepreneurs, Roni Barak, estime que « le nouvel indice ne reflète toujours pas pleinement l’impact de la guerre sur le secteur de la construction. Le doublement, voire le triplement des salaires dans les métiers dits humides (gros œuvre) n’est que partiellement intégré. »
Selon lui, le CBS a fait un premier pas important en actualisant les pondérations, mais doit poursuivre l’effort afin de coller davantage à la réalité économique actuelle, marquée par une pénurie chronique de main-d’œuvre face à une demande croissante de reconstruction.
Une hausse annuelle modérée malgré la crise
Sur une période de 12 mois, l’indice a progressé de 5,5 %, et de 4,2 % depuis le début de l’année. Depuis le début de la guerre, la hausse cumulée atteint 7,3 %, un chiffre qui reste relativement proche de l’inflation générale (6,2 %) – et très éloigné des hausses de coûts revendiquées par les professionnels.
Certains observateurs estiment que le véritable problème est celui du calendrier : les hausses salariales majeures ayant eu lieu dès 2023, les ajustements de l’indice sont arrivés trop tard pour les refléter pleinement. Autrement dit, le décalage temporel entre l’évolution des coûts réels et leur prise en compte statistique pourrait être la source principale de la frustration actuelle.