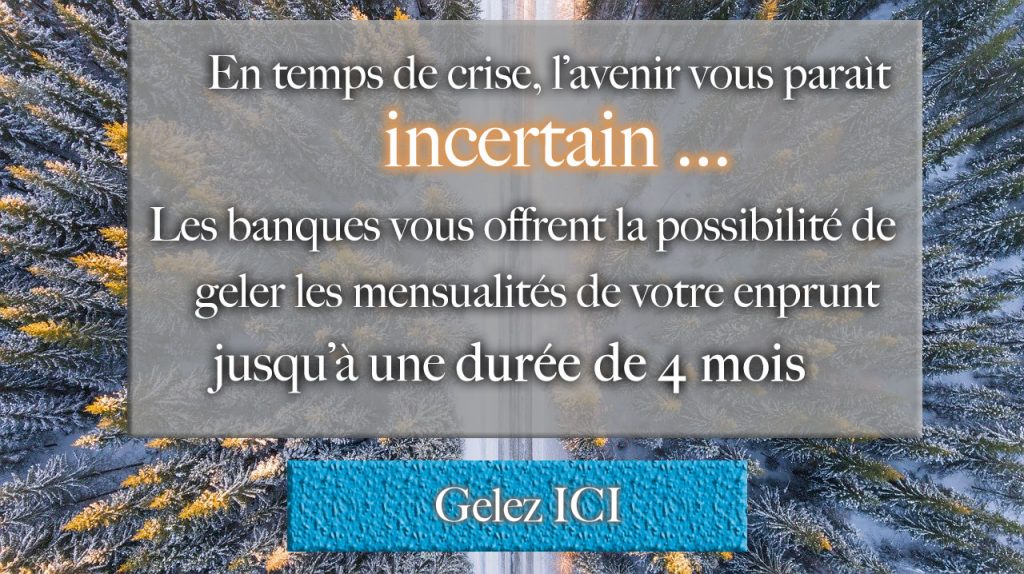L’année 2018 avait commencé dans une ambiance euphorique sur les marchés, Wall Street battait record sur record et Donald Trump s’auto-congratulait à chaque nouveau sommet du Dow Jones. Pourtant 2018 s’est achevée dans la déprime pour les investisseurs. La plupart des places boursières mondiales affichant une évolution négative sur les douze mois.
Wall Street qui avait été suffisamment robuste pendant une bonne partie de l’année pour supporter, à la fois une guerre commerciale et un resserrement monétaire, a fini par céder. L’essentiel de la baisse a été réalisée sur les trois derniers mois de l’année. L’inquiétude s’est emparée des investisseurs et les cours ne sont jamais parvenus à repartir réellement de l’avant. Le bilan annuel négatif clôt la longue phase d’ascension qu’ont connu les marchés américains.
L’année 2018 montre certains paradoxes : elle restera comme une année de croissance mondiale soutenue (3,7 %), avec un environnement inflationniste favorable et des profits encore en hausse, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. En outre, aucune grande catastrophe économique et financière ne s’est produite, comme les marchés ont pu le connaitre dans le passé. Mais l’incertitude qui a plané sur les échanges commerciaux, conjuguée à la hausse des taux US, a fortement pesé sur les actions et a annulé l’effet de la forte croissance des bénéfices.
Par ailleurs, les menaces de nature politiques se sont multipliées, Italie, Brexit ont servi de fil rouge au fil des mois.
Autre facteur de perturbation, le caractère imprévisible de la politique de Trump qui n’avait jusqu’alors eu que peu d’effet sur les actions, a commencé à inquiéter les marchés, à mesure que le président américain mettait à exécution ses menaces protectionnistes. La crainte d’un ralentissement économique a été ravivée et a contribué à la perte de confiance des investisseurs dans la capacité de Trump à soutenir les actions.
Les récentes secousses sur les marchés sont aussi révélatrices de la fin d’une politique très accommodante des banques centrales. L’ère de “l’argent pas cher” et des taux très bas est en train de s’achever. Pour autant, le contexte financier reste encore porteur. Les taux directeurs aux États-Unis sont toujours bien en-dessous des 3%, malgré dix ans de croissance et un plein emploi bien installé.
Les relations tendues du président américain avec la Fed, en fin d’année, et la fermeté de Jerome Powell n’ont pas contribué à créer un biais favorable qui aurait pu être un catalyseur.
Les investisseurs espéraient que la Fed enverrait des signes d’un adoucissement de son processus de normalisation monétaire, face au risque de ralentissement économique. Cela aurait pu être le déclic permettant de mettre fin à la chute rampante des actions. Un espoir déçu. Le signe n’est pas venu. Jerome Powell et les membres du FOMC sont restés insensibles aux pressions de Donald Trump.
Le shutdown que connaissent actuellement les États-Unis a ajouté encore un peu plus de pression. Donald Trump s’est engagé dans un bras de fer avec le Congrès pour obtenir le financement du mur, de 5 milliards de dollars, qu’il a promis d’achever entre les États-Unis et le Mexique.
Résultat, sur l’ensemble de l’année, le S&P accuse un recul de 6,2%, tandis que le Dow abandonne 5,6% et le Nasdaq Composite 3,8%. Ces pertes ont été concentrées sur le dernier trimestre de l’année.
Même les géants de la « Tech », dernières valeurs refuge, ont fini par céder malgré la robustesse de leur modèle économique, alors qu’ils ont été le principal moteur de la hausse de Wall Street, ces dernières années. Ces valeurs ont été impactées par les retombées des premières sanctions commerciales, notamment Apple qui fragmente sa production entre plusieurs pays dans le monde. Première capitalisation boursière, sa baisse a entrainé tout le secteur technologique avec elle et l’ensemble des indices boursiers.
En 2018, les risques ont aussi refait surface dans la zone euro, entraînant des sorties importantes de la part des investisseurs.
En plus d’un ralentissement de la croissance dans la zone, dans le sillage notamment de l’Allemagne pénalisée par le ralentissement chinois et la Guerre commerciale, l’Europe a été un véritable concentré des craintes politiques et les pertes sont plus sévères sur les marchés. Elle doit gérer la montée des populismes sur une large part du Continent entre le Brexit, le budget italien, le vacillement d’Angela Merkel et, en fin d’année, l’impact négatif des « gilets jaunes » sur la croissance française.
Le Dax allemand, riche en grands groupes exportateurs, a perdu plus de 18 % en 2018. L’indice CAC 40 a terminé l’année 2018 sur une baisse de près de 11% et a plutôt mieux résisté que les autres marchés européens, alors que l’Euro Stoxx 50 a perdu plus de 14 % de sa valeur en un an. La bourse de Paris le doit à deux secteurs qui ont surfé sur leur bon début d’année : l’aéronautique et le luxe.
Beaucoup de risques ont sans doute été surestimés. Mais à partir du moment où le doute s’introduit dans l’esprit des investisseurs, cela crée de la volatilité et le marché corrige à la moindre mauvaise nouvelle. En cela l’année 2018 aura marqué le grand retour de la volatilité.
- 2018 : GUERRE COMMERCIALE
Personne n’avait vraiment cru que Donald Trump oserait s’attaquer aux chinois. Il l’a fait. Si Trump semble avoir autant de griefs envers la Chine, c’est qu’il reproche au pays de ne pas respecter les règles du jeu du commerce international.
Ce qui finalement est loin d’être faux. La Chine est connue pour réserver ses marchés publics aux entreprises chinoises. Trump reproche aussi le pillage des technologies américaines. La Chine a par exemple fermé le pays aux concurrents de type « Amazon » pour permettre à « Alibaba » de devenir un géant.
Mais la Chine n’est pas la seule concernée, l’Europe aussi est désignée comme un « ennemi commercial ». La menace américaine d’imposer une surtaxe sur les voitures importées, plane toujours comme une épée de Damoclès sur les relations transatlantiques. Ce qui s’est ressenti sur les constructeurs allemands.
L’idée générale de Trump est donc de rendre plus cher les produits étrangers en les surtaxant, afin de les rendre moins compétitifs face aux produits américains.
Mais cette technique n’est pas sans risque et peut s’avérer contre-productive. D’abord parce-que les adversaires en question peuvent répliquer. C’est ce qui s’est passé avec la Chine, qui a imposé des taxes supplémentaires sur les produits américains « de base » qui entrent sur son territoire : le soja, le porc, ou le coton. Des mesures de rétorsion qui ont rendu inquiets les agriculteurs américains, qui ont de plus en plus de mal à écouler leurs récoltes, leur production devenant de facto plus chère et moins productive. Pour calmer la base de son électorat, Trump a dû leur fournir une aide de plusieurs milliards. Mais il ne pourra pas continuer, indéfiniment, à fournir des aides à chaque secteur se trouvant en difficulté suite à ses mesures commerciales.
De plus, en rendant les produits importés plus chers c’est le consommateur américain qui est indirectement impacté. Un exemple symboliquement très significatif : Coca-Cola. L’entreprise achète en Chine la majeure partie du métal de ses canettes. Les couts de production de la société ont donc été alourdis par les taxes sur le métal. Coca-Cola n’a eu d’autre choix que d’augmenter le prix de ses sodas. C’est donc le consommateur américain qui finit par payer la facture de cette stratégie de Trump (censée protéger les américains).
Autre souci dans la réflexion du président américain, il pense qu’en bloquant la concurrence extérieure, les États-Unis produiront directement dans le pays et que ça créera des emplois. C’est une erreur. D’abord, parce-que les États-Unis sont déjà en plein emploi et on imagine mal Trump faire appel à de la main d’œuvre étrangère. D’autre part, parce-que les États-Unis ne produisent pas ce qu’ils importent.
Aujourd’hui, il n’y a pas d’offre alternative à ce que produit la Chine : 80% des produits achetés par les américains ne sont pas fabriqués aux États-Unis, soit parce que ça leur coûte trop cher, soit parce qu’ils n’ont pas les composants sur leur sol. Au final ces produits seront sans doute importés ailleurs. La manœuvre de Trump s’avère donc, en plus d’être risquée, totalement inutile.
Le président américain est sans doute en train de le réaliser. Le 1er décembre, Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont fini par se rencontrer à Buenos Aires, en marge du sommet du G20. Les deux parties sont arrivées à un un accord de principe, comprenant la cessation des droits de douanes supplémentaires pendant trois mois, le temps de négocier et de résoudre les différends pour arriver à un accord final.
Pourtant malgré cet espoir, la nervosité des marchés ne s’est pas dissipée en fin d’année. La Chine et les États-Unis sont deux mastodontes de l’économie mondiale. À eux deux, ils représentent environ un tiers du PIB de la planète. Par conséquent, le manque de visibilité, en attendant le terme de ces 90 jours, continuera à entretenir la volatilité sur les marchés.
- 2018 : BANQUES CENTRALES
Depuis 3 ans, la Fed resserre sa politique monétaire et depuis la fin de l’année, la BCE a mis fin à son programme d’achat d’actifs.
Après plusieurs années de politiques monétaires accommodantes, c’est un changement radical de contexte financier pour les investisseurs.
Si la Banque Centrale Européenne entame timidement son processus de normalisation monétaire, la Fed, elle, est passée à la vitesse supérieure et aura marqué l’actualité en 2018. D’abord avec son changement de président. Jerome Powell a pris le relai de Janet Yellen à la tête du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine.
A sa tête, le nouveau président de la Fed a accéléré le processus de normalisation enclenché par Janet Yellen, en augmentant les taux directeurs par quatre fois cette année.
Si les trois premières hausses de taux de l’année 2018 ont été plutôt bien acceptées par les investisseurs, la dernière hausse annoncée en décembre, a été accueillie froidement par Wall Street. Pourtant les taux directeurs à 2,25%-2,50%, restent encore bien en dessous du taux « neutre » qui se situe autour de 3,25. C’est-à-dire un niveau de taux qui permet à l’économie de continuer à croître, sans être ni pénalisée, ni trop stimulée.
Pourtant les marchés ont été déçus par le ton moins souple que prévu de Jerome Powell. Ce dernier étant considéré comme un pragmatique, les investisseurs espéraient un signal de pause, au vu des risques qui pèsent sur l’économie mondiale. Son ton plus “hawkish” a réintroduit de l’incertitude sur sa politique monétaire.
La Fed a fait savoir qu’elle prévoyait toujours de poursuivre des “hausses de taux graduelles” au vu de l’expansion continue de l’activité économique, de la vigueur du marché de l’emploi, et d’une inflation proche de son objectif de 2% à moyen terme.
La Fed prévoit donc encore deux hausses de taux en 2019. Or, face à une accumulation de signes de faiblesse de l’économie mondiale, les marchés espéraient un seul tour de vis en 2019.
Mais pour Jerome Powell le contexte macro-économique reste robuste. Il n’a donc pas semblé s’affoler de la correction des indices boursiers.
Donald Trump n’a pas manqué de critiquer cette non-flexibilité de la Federale Reserve. Le président américain n’a eu de cesse, ces dernières semaines, de réclamer à Jerome Powell une pause dans son cycle de hausse des taux, l’accusant de freiner la croissance.
Trump, avec ses messages, a sans doute produit l’effet inverse de celui escompté. La Fed ne doit certainement pas montrer qu’elle est influençable. De plus, à force de critiques régulières contre Powell et sa politique de resserrement monétaire, les investisseurs ont commencé à avoir des craintes sur le fait que le président de la Fed puisse rester à son poste. Or, dans le désordre qui règne actuellement dans l’administration américaine, Jerome Powell reste un facteur de stabilité qui rassure les investisseurs.
Jamais un président des États-Unis n’a destitué celui de la Fed et un tel précédent aurait jeté un sérieux doute sur l’indépendance de la banque centrale par rapport au pouvoir exécutif. Mais ce doute a été dissipé assez vite, la Maison Blanche a assuré que le poste de Jerome Powell à la présidence de la banque centrale américaine n’était aucunement menacé.
Si la Fed a été beaucoup critiquée sur son entêtement à poursuivre sa hausse des taux, il faut comprendre qu’il est difficile d’arrêter pour l’instant ce processus, sans que les indicateurs économiques se dégradent. Les États-Unis sont au plein-emploi et les salaires augmentent enfin. Ce qui n’est pas vraiment le signe d’une économie qui va mal.
Par ailleurs, la Fed veut se laisser encore un peu de temps pour reconstituer des marges de manœuvre et pouvoir baisser ses taux, en cas de véritable crise.
- 2018 : BREXIT
L’année 2018 a également été dominée par les négociations entre la commission européenne et le gouvernement britannique. Dans moins de 100 jours, le Brexit sera « théoriquement » effectif et la Grande-Bretagne ne fera plus partie de l’Union Européenne.
En théorie, car depuis plus de deux ans après le référendum, les choses sont loin de se passer de manière ordonnée, tant cette sortie est inédite et les conséquences sont complexes à mettre en place dans la réalité.
Mais l’horloge tourne et l’étau se resserre avant la date fatidique du 29 mars 2019. Le flou entourant tout ce processus de sortie a pesé sur le moral des investisseurs.
Toutefois une première victoire s’est dessinée. Theresa May a réussi la prouesse de sceller un accord avec l’Union Européenne sur les modalités de sortie de ce Brexit. Le fruit de plus de deux ans d’âpres négociations.
L’accord négocié avec l’UE maintient le Royaume-Uni dans le marché unique pour les biens, avec la promesse de conclure un accord ambitieux sur le commerce et la coopération politique. Le filet de sécurité irlandais, permet aussi d’éviter le retour d’une frontière physique sur l’île d’Irlande.
Cet accord de divorce est une sorte de compromis pragmatique entre les partisans du « Leave » et ceux du « Remain ». Pourtant, même s’il a été validé de justesse par le gouvernement britannique, cet accord est loin de faire l’unanimité. Il est d’ailleurs sévèrement critiqué par les deux camps. Ce qui montre qu’un compromis sur le sujet est très compliqué. Pour que l’accord entre en vigueur, il faut désormais que Theresa May le fasse ratifier par le Parlement.
Ce vote est prévu autour de la mi-janvier. Un premier vote prévu le 11 décembre avait été annulé par Theresa May pour éviter une défaite annoncée. Elle s’est donnée du temps pour pouvoir convaincre la poignée de députés conservateurs qui lui manquent et retourner à Bruxelles chercher quelques concessions nouvelles, qu’elle n’a toujours pas obtenues.
La commission Européenne devrait lâcher un peu de lest si elle ne veut pas mettre en péril le processus de sortie.
Fait étonnant, le camp des « Brexiter » semble s’être singulièrement dégarni. Même si les plus fervents partisans du Brexit estiment que l’accord est largement décevant et craignent qu’il laisse Londres sous influence européenne. D’autres « brexiter » plus réalistes commencent à s’inquiéter du scénario d’un nouveau référendum, si cet accord était tenu en échec. Un nouveau référendum qui pourrait leur être défavorable, au vu du renversement de l’opinion publique qui est désormais favorable à un maintien de la Grande Bretagne dans l’UE.
Ces pro-Brexit, qui s’opposaient jusqu’ici à Theresa May, pensent désormais que son accord serait en fait la seule manière d’être 100% certains que le Brexit ait lieu le 29 mars 2019. Ces derniers pensent aussi que, ne pas le voter au parlement, serait s’exposer à un risque que le Brexit n’ai jamais lieu. Ce revirement est positif pour Theresa May, même si la partie est encore loin d’être remportée.
Le Royaume-Uni est donc coincé dans un état de paralysie politique en attendant l’issue du vote au parlement le 15 janvier. Les incertitudes demeurent à l’approche de l’entrée en vigueur du Brexit, le 29 mars prochain, mais les investisseurs estiment toujours que Theresa May est la plus à même de mener cet accord jusqu’au bout.
- 2018 : ANGELA MERKEL, FIN DE RÈGNE
L’année 2018 a marqué le début de la « fin de règne » d’Angela Merkel. Le 29 octobre, la chancelière allemande a annoncé qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat comme présidente de la CDU, mais qu’elle restera chancelière jusqu’à la fin de son mandat, en 2021.
Âgée de 64 ans, déjà élue quatre fois, elle tire ainsi les conséquences de l’affaiblissement de son parti. Elle est usée personnellement par treize années au pouvoir, mais elle assure rester jusqu’à la fin de son mandat de chancelière en 2021.
Cette décision fait suite à une succession de déconfitures électorales. L’Allemagne a rejoint la liste des pays européens connaissant un déclin spectaculaire des partis de gouvernement traditionnels.
Comment se fait-il que les Allemands soient si mécontents ? L’économie reste encore en forme, les caisses de l’État sont pleines et le chômage à la baisse. Mais le sujet n’est pas l’économie, Merkel fait clairement les frais de sa politique migratoire très critiquée. C’est un sujet qui ne peut plus être ignoré.
L’annonce de son départ l’a affaiblie sur le plan international. En Europe notamment, au moment où l’Union européenne traverse une crise politique.
Son départ annoncé laisse un vide de leadership au niveau européen. La France était la candidate la plus probable pour prendre le relais de l’Allemagne à la tête de l’Europe, mais elle est désormais engluée par trop de problèmes internes.
La fin de l’ère Merkel apparait comme le signe avant-coureur qu’un cycle s’achève, alors que s’ouvre pour l’Allemagne le temps des incertitudes.
Au-delà des craintes sur le ralentissement de l’économie chinoise qui mettrait ses exportations en difficulté, l’Allemagne semble être au bout de son cycle structurel.
Les secteurs dans lesquels elle surperforme sont les « économies d’hier ». L’automobile allemande réputée pour la solidité de ces moteurs thermiques, se trouve aujourd’hui mise en concurrence par les moteurs électriques, qui ne sont fabriqués que par les chinois et les américains. Étonnamment, les allemands semblent être en retard dans les nouvelles technologies. L’Allemagne est au bout d’un cycle industriel. La technologie nécessaire pour un moteur électrique est simple et ne nécessite pas le savoir-faire industriel allemand. C’est techniquement moins sophistiqué. Et, à terme, beaucoup de pays seront à même de les fabriquer.
L’avantage de l’Allemagne est qu’elle a les moyens de faire sa transition technologique. Le pays est en plein emploi, a un excédent budgétaire, un excédent commercial. Les allemands ont donc des des marges de manœuvre pour repenser leur modèle et faire la transition.
Mais pour les marchés, la faiblesse d’Angela Merkel dans le paysage politique européen, est venue grossir le flot d’incertitudes politiques qui planent sur l’Europe. Les défaites électorales et l’usure du pouvoir, sans doute, ont eu raison de la chancelière qui, aux yeux du monde, incarnait l’Europe. Un tournant pour l’Allemagne, pour l’Europe et pour le monde.
- 2018 : FRANCE, « GILETS JAUNES »
2018 sonnera comme le retournement d’un espoir en Europe porté par le président Macron.
Le jeune gouvernement français donnait jusque-là une certaine lisibilité pro-réformes, avec une feuille de route dégagée et assez claire, saluée par la presse internationale et suffisamment pro-business pour générer de la confiance auprès des investisseurs. Mais le mouvement des “Gilets Jaunes” en France est venu contrarier cette image et a exposé des problèmes profonds telles que les disparités économiques et sociales en Europe.
Tous les week-ends, depuis mi-novembre, les « gilets jaunes » sont descendus dans la rue pour protester, au départ, contre la hausse des prix de l’essence résultant d’une hausse des impôts du gouvernement. Des manifestations dans toute la France, qui ont dégénéré en violences. Un chaos que le gouvernement a eu du mal à gérer et qui a gravement porté atteinte à l’économie française et à l’image de la France.
Pour apaiser toute cette tension Emmanuel Macron n’a pas eu d’autres choix que de sortir l’artillerie lourde, en annonçant des mesures sociales conséquentes.
Avec ce cadeau social, Macron sacrifie les 3% du pacte budgétaire européen et choisit de redonner du pouvoir d’achat pour soutenir la demande.
Le président français a dû faire l’arbitrage entre deux choix impossibles. Il a passé 18 mois de son quinquennat à être le bon élève de l’Europe, pour avoir des concessions de l’Allemagne. Mais cette politique l’a mené à une impasse, il s’est mis la population à dos. A contrario, en tentant de regagner les faveurs des français, il perd sa crédibilité en Europe. Sous l’œil européen, la France est redevenue ce pays englué dans ses conflits sociaux, incapable de se réformer et gouvernée par un président qui est pieds et poings liés.
La feuille de route est désormais brouillée. Les revendications sociales seront difficiles à satisfaire et il y a beaucoup de pédagogie à faire autour des réformes pour qu’elle puissent être appliquées sans heurts. Et le manque de pédagogie est sans doute ce qu’a raté le président Macron.
Au niveau des investisseurs, la France a été épargnée, il n’y a pas eu de volatilité sur le spread Oat/Bund. Cela traduit un capital de confiance qui ne s’est pas encore érodé. Si Macron conserve un capital de confiance financier important, son capital politique est très entamé.
- 2018 : ITALIE
Les élections du 4 mars 2018 en Italie ont marqué une rupture politique : les partis traditionnels se sont effondrés face aux formations qui se revendiquent « antisystème ».
L’arrivée au pouvoir de la coalition populiste, formée par la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), ont rebattu les cartes du système politique italien et semé le trouble dans l’esprit des investisseurs, qui ont vu la solidité de la zone euro mise à l’épreuve.
Ces inquiétudes sont montées d’un cran en septembre à mesure que le gouvernement italien multipliait les déclarations contradictoires à propos de son budget 2019. De quoi préoccuper Bruxelles et les marchés.
Le gouvernement italien a, en effet, pris les investisseurs de court en annonçant un objectif de déficit public pour 2019, de 2,4% du PIB. Un niveau supérieur au seuil de 2% que le ministre de l’Economie, Giovanni Tria, avait fixé comme une limite à ne pas dépasser.
Pourquoi le budget italien proposé de 2,4% a posé problème, sachant que la règle européenne est de ne pas dépasser la barre des 3% ? L’union Européenne a estimé que ce budget représentait encore des dépenses inutiles, destinées à calmer des revendications populistes et n’était pas de nature à faire repartir la croissance, de quoi enfoncer encore un peu plus la dette publique qui dépasse les 130% du PIB. Ce n’est donc pas tant le montant du budget qui pose problème mais ce qu’il y a à l’intérieur de ce budget. Si pour 2,4% du PIB l’Italie s’était engagée à faire des réformes structurelles, l’Union Européenne aurait certainement validé le budget.
Bruxelles peut se montrer parfois flexible avec ces règles. Elle l’a fait avec le Portugal ou l’Espagne qui en contrepartie ont entamé des réformes profondes dont les pays en récoltent les fruits aujourd’hui. Pour bénéficier de l’indulgence de la Commission Européenne, il faut en échange appliquer des réformes structurelles, ce que faisait l’ancien premier ministre italien Matteo Renzi.
Cette interrogation autour du budget italien et de l’entêtement du gouvernement a vite été sanctionné par les marchés. Le taux à 10 ans italien s’est envolé. Au final c’est le marché qui a servi d’arbitre. Le gouvernement italien n’est pas complètement inconscient et est très attentif à l’évolution du “spread”, l’écart entre le taux allemand, le plus sûr, et le taux italien. Au-delà d’un certain niveau, si cet écart de spread s’élargit trop, ce qui a été le cas après la présentation de leur premier budget, les taux longs italiens s’enflamment rendant la charge de la dette italienne encore plus lourde et mettant en péril l’économie. Une situation financière que le gouvernement ne peut pas se permettre.
C’est pourquoi Rome a choisi, en définitive, d’aller dans le sens de Bruxelles. Le gouvernement a revu son déficit, à la baisse à 2,04% du PIB (contre 2,4% au départ). La Commission européenne avait rejeté, à l’automne, la version initiale du premier budget porté par la coalition populiste au pouvoir. L’Italie a compris le message : elle doit contenir sa dette pour éviter une sanction des marchés financiers et une procédure d’infraction de l’UE. C’est la bonne nouvelle de la fin d’année 2018.
- 2018 : HAUSSE DU DOLLAR
Sur l’ensemble de l’année 2018, le dollar s’est apprécié d’environ 5% face à l’euro. La devise américaine profite du fait que la Réserve fédérale est la seule banque centrale à resserrer de manière aussi soutenue sa politique.
Le dollar a mécaniquement réagi aux quatre hausses de taux d’intérêt opérées par la Reserve Fédérale américaine en 2018. Les hausses de taux rendent le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif aux yeux des investisseurs. La quatrième hausse en décembre a offert encore un peu plus d’élan à la devise américaine.
En plus du resserrement monétaire le dollar a pu profiter de son statut de valeur refuge. L’accroissement des incertitudes mondiales” et la guerre commerciale ont, en effet, favorisé les achats d’actifs réputés peu risqués, comme le dollar, qui reste la devise de réserve mondiale et toujours un refuge de choix pour de nombreux investisseurs.
La croissance américaine toujours solide malgré un ralentissement mondial a également soutenu la monnaie américaine.
Dans ce contexte, l’euro a été logiquement pénalisé par le regain d’intérêt des investisseurs pour le dollar.
La devise européenne a également souffert d’un terrain politique sous tension dans la zone euro (Brexit, politique italienne) et de la faiblesse de la croissance économique.
Les écarts de croissance entre les deux côtés de l’Atlantique justifient sans équivoque la baisse de la paire eur-usd.
La récente désescalade des tensions sur le budget entre l’Union européenne et l’Italie a toutefois aidé à calmer la baisse concernant l’euro, qui a terminé l’année autour des 1,14$.
- 2018 : BAISSE DU PÉTROLE
L’année 2018 a été difficile pour l’ensemble des matières premières qui ont pâti de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Mais particulièrement pour le cours du baril, qui accuse une perte annuelle de 19% pour le Brent et de 20% pour le WTI. Le baril a perdu, sur le dernier trimestre de l’année, plus d’un tiers de sa valeur !
Le principal déclencheur de cette baisse a été le changement de visibilité par rapport à l’Iran. Les inquiétudes sur l’offre qui prévalait sur la première partie de l’année en raison des sanctions imposées par les Etats-Unis à l’Iran ont brusquement changé, quand Trump a assoupli sa position face aux exportations iraniennes.
Le marché a dû subir un gros mouvement technique suite à ce revirement inatendu. Les fonds spéculatifs avaient pris des positions, largement à la hausse, sur l’idée que les sanctions iraniennes allaient faire disparaitre le pétrole iranien du marché et que ça créerait ‘de facto’ une flambée des prix. Mais Trump qui est obsédé par le prix de l’essence à la pompe pour les américains, a cru bon, avant les élections-de mi-mandat d’assouplir les sanctions contre l’Iran pour faire baisser le prix du baril. Les chinois et indiens, les deux acheteurs majeurs du marché ont le droit d’acheter du pétrole iranien pour une extension de 6 mois sans risque de sanction. Résultat, le pétrole iranien reste sur le marché et la crainte sur l’offre à l’origine de la hausse du pétrole n’a plus lieu d’être.
Après avoir culminé à plus de 80 dollars au début de l’automne, le baril de Brent a glissé sur les trois derniers mois de l’année, pour se rapprocher des 50$ fin décembre.
Les tentatives de l’OPEP et ses alliés pour réduire la production se sont révélées infructueuses. Le cartel des pays producteurs a convenu d’une réduction globale de leur production de 1,2 million de barils par jour pendant au moins six mois à partir de janvier.
Toutefois l’annonce n’a guère convaincu le marché, les opérateurs doutant que tous les membres respectent réellement leurs engagements.
Par ailleurs le ralentissement économique en Chine a laissé place à un pessimisme sur la demande.
L’offre a fortement augmenté et la crainte d’une contraction de la demande a effrayé les investisseurs, il n’en fallait pas plus pour faire vaciller le baril.
- 2018 : OR, VALEUR REFUGE
Le métal jaune a connu un retour en grâce ces dernières semaines, retrouvant son statut de valeur refuge dans un contexte économique et boursier incertain.
Avec les nombreuses incertitudes qui tourmentent les marchés financiers, l’or joue à nouveau son rôle de valeurde protection et suit une tendance haussière depuis le mois de novembre. Après avoir atteint son niveau le plus bas depuis deux ans en août dernier, le cours de l’or a connu une belle progression sur le dernier trimestre 2018, notamment en décembre où il a pris 5% pendant les séances agitées sur les places boursières., son meilleur mois depuis dix ans. Il finit l’année 2018 autour des 1285$.
L or généralement le premier investissement en cas d’aversion au risque, avait pourtant du mal à gagner du terrain pendant la plupart de l’année 2018. La hausse du dollar a eu un impact négatif sur le prix du métal fin (coté en dollars), puisqu’elle le rend mécaniquement plus cher pour les acheteurs munis d’autres devises. Mais la stabilisation du dollar en fin d’année a permis a l’or de retrouver de l’attrait.
La hausse du taux à 10 ans US au dessus des 3% a également eu un impact négatif sur le métal jaune, qui évolue généralement à l’inverse des taux d’intérêt. L’or ne générant pas de revenu, il pâtit d’arbitrages défavorables quand les taux d’intérêts ou les emprunts d’Etat augmentent. Alors qu’il avait dépassé les 3,20% en octobre derniers, il finit l’année autour de 2,7%. Une baisse qui constitue un bon point pour l’or.
Pour autant, sur l’ensemble de l’année, le métal jaune reste en repli de 1,5%. Les craintes autour du ralentissement économique de la Chine ont aussi pesé sur les métaux précieux en 2018.
CONCLUSION : PERSPECTIVES 2019 ?
Après une année 2018 plus compliquée que prévu pour les investisseurs, le scénario 2019 est fragilisé. 2018 restera comme une année de transition, le point d’inflexion vers un futur un peu plus incertain. Les thèmes qui ont entraîné des turbulences sur les marchés, depuis octobre, devraient rester présents au cours de cette année, il faudra donc faire preuve de réactivité face à cette volatilité qui va perdurer.
Les incertitudes sur la guerre commerciale, la crise politique que traverse l’Europe, le ralentissement chinois risquent de peser sur les bourses mondiales en 2019, mais le tableau n’est toutefois pas aussi sombre qu’il n’y paraît.
Bien que la visibilité se dégrade, le niveau général de valorisation s’est dégonflé. Une fois que les investisseurs auront cessé de surestimer les risques, il y a du potentiel de rebond. Le pessimisme a été excessif, les risques sont certes nombreux, mais avec une gravité nettement inférieure que ce qu’il n’y parait, si on les analyse un par un.
La première question est de savoir si les fondamentaux sont suffisamment solides pour stabiliser les marchés mondiaux ? Selon l’OCDE la croissance mondiale devrait s’établir à 3,5 % en 2019 et 2020, après 3,7 % cette année. Soit une baisse de régime en douceur. Il est donc un peu tôt pour évoquer une récession.
Aujourd’hui, ce qui fait en grande partie la fragilité du marché, c’est que l’économie américaine, qui comptabilise dix ans de cycle haussier depuis 2009, donne le sentiment que ces années très porteuses tirent à leur fin. La baisse du dernier trimestre 2018 est beaucoup plus liée à ce biais psychologique, qu’à un contexte économique qui se serait fortement dégradé.
L’année 2019 devrait être le siège d’un ralentissement général, avec un cycle économique aux États-Unis qui arrive à maturité, mais qui reste solide selon les estimations. Le problème est que cette configuration de fin de cycle US, arrive dans un environnement de tensions politiques et de resserrement monétaire. Tout cela devrait donc se traduire par une augmentation de la volatilité sur les actions.
La position de la Fed en 2019 sera, également, centrale pour les marchés. Certes, elle a besoin de se reconstituer des marges de manœuvre en prévision d’une récession qui pourrait avoir lieu en 2020/2021, mais un adoucissement de son discours pourrait être une aide sérieuse pour le marché, qui a besoin de faire une pause. Les derniers propos de Jerome Powell vont d’ailleurs dans ce sens. Il s’est employé vendredi à rassurer les marchés financiers sur les risques liés à un ralentissement de la croissance aux États-Unis, en déclarant que la dynamique de l’économie restait solide et que la Fed serait attentive aux risques de dégradation de la situation.
En Europe, en revanche, beaucoup d’investisseurs doutent de plus en plus des perspectives économiques et boursières de la zone euro. L’Allemagne, fortement exportatrice, affectée par les tensions commerciales, affiche un recul de son PIB. L’ambiance morose en Allemagne a des répercussions sur toute la zone euro. Le contexte n’est donc pas très favorable à l’investissement en actions à court terme. La baisse de ces derniers mois en Europe, si elle dure encore, pourrait effectivement, à terme, amplifier cette morosité économique.
Un scénario positif pourrait néanmoins se profiler. La BCE qui ne voudra certainement pas perdre le bénéfice de tant d’années de soutien, pourrait à un moment donné annoncer qu’elle poursuit son soutien à l’économie en repoussant par exemple le début de son resserrement monétaire (qu’elle n’a toujours pas commencé, elle termine à peine son QE). Elle a d’ailleurs annoncé il y a quelques jours qu’elle accordait des liquidités supplémentaires aux banques. Cette nouvelle est passée inaperçue, mais constitue un signal positif fort.
D’un point de vue politique, le problème de la dette italienne semble sous contrôle. Le gouvernement italien a compris qu’il était contre-productif d’être sanctionné par les marchés et semble avoir retenu la leçon de la flambée de ses taux longs. L’Union Européenne de son côté ne peut pas se permettre une nouvelle crise, comme avec la Grèce et fera tout pour l’éviter.
Le Brexit reste un risque fort, sur le premier trimestre de l’année, à mesure que l’échéance du 29 mars (qui doit acter la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l’UE) approche. Sur ce sujet aucun scénario n’est privilégié et tout reste possible, à ce stade. Même si comme on l’a expliqué, le camp des pro-Brexit commencent à s’essouffler. Theresa May reste un facteur de stabilité, si elle venait à être « limogée », la situation pourrait impacter le marché plus gravement.
Autre crainte des investisseurs pour 2019 : la décélération de la croissance chinoise. La Chine est dans un processus de désendettement, elle est en train de réformer son secteur privé de manière très forte. Ces restructurations pèsent, inévitablement, sur l’économie du pays. Mais si on garde une logique rationnelle (et non épidermique, comme c’est souvent le cas dès lors qu’il s’agit de la Chine), le pays est en train de se doter d’une économie plus saine et moins opaque. Ce qui sera, à terme, positif pour son économie. La guerre commerciale est venue se greffer, comme un élément inattendu et agressif, dans ce processus de réformes. Cependant, la Chine a les moyens d’inverser la tendance. Dans le cas où la confiance viendrait à chuter trop lourdement, le gouvernement peut soutenir son économie domestique : en remettant par exemple le crédit disponible sur certains secteurs, en réduisant la fiscalité etc.… C’est la raison pour laquelle il ne faut pas être trop pessimiste sur le contexte chinois.
Enfin, l’accord commercial Chine-US sera certainement l’un des dossiers les plus sensibles en 2019. C’est ce qui pourrait ou non accélérer le ralentissement mondial.
Ça n’est pas une surprise, les États-Unis arrivent en bout de cycle, mais Donald Trump a la capacité de prolonger ce cycle d’encore un ou deux ans. Et pour ce faire, il doit signer un accord avec la Chine, auquel cas il risquerait de casser la croissance américaine. Les premières taxes sur les importations commencent déjà à rogner sur la compétitivité des entreprises américaine. La Chine, de son côté, en pleine restructuration a également besoin de cette relance.
Les marchés pourraient trouver un sens nouveau si un accord était validé. L’important étant de stabiliser les relations avec la Chine pour restaurer la confiance.
Dans le scénario contraire, si Trump s’entête dans son protectionnisme et met en place les taxes sur les 200 milliards d’importations chinoises, il organise son suicide politique. En taxant cette frange d’importations, il s’attaque aux produits de consommation courante, qui verront leur prix augmenter de facto de 20%.
Rappelons que 70% du PIB américain provient de la consommation des ménages. Une telle stratégie, serait un manquement à ses promesses électorales, alors qu’il a promis aux américains d’augmenter leur pouvoir d’achat. Les électeurs ne lui pardonneront pas. Les américains n’ont jamais réélu un président qui les a menés à la crise. S’il s’entête, il signe sa propre disgrâce.
Encore une fois c’est Donald Trump qui va porter la responsabilité du scénario des marchés en 2019. Dans quel sens il va aller, c’est au-delà de la capacité de prévisions de n’importe quel économiste.
Toutefois, les derniers signes en provenance de Chine montrent que les négociations sont pour l’instant en bonne voie. Les deux pays semblent arriver à un point où ils sont convaincus de délivrer un accord. Trump est très réceptif à l’évolution des marchés financiers et il essaiera probablement d’arrondir les angles. C’est ce qui donnera le « tempo » du marché.
La volatilité pourrait donc être particulièrement forte au cours du premier trimestre, évoluant au gré des discussions entre Washington et Pékin. Les messages de prudence à court terme restent d’actualité dans ces circonstances.
Mais le mois de mars pourrait marquer un tournant. Les Etats-Unis se sont en effet donnés jusque-là pour parvenir à un accord sur le commerce avec la Chine. Faute de quoi, de nouveaux droits de douane seront imposés. « Mars sera décisif ».
Précision : Les informations contenues dans cet article n’engagent que le rédacteur et ne sauraient se substituer à un conseil financier spécifique. Elles ne sont valables qu’à la date de leur rédaction uniquement.